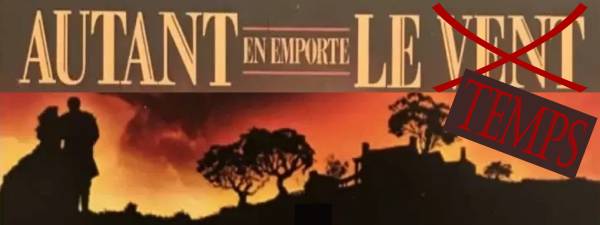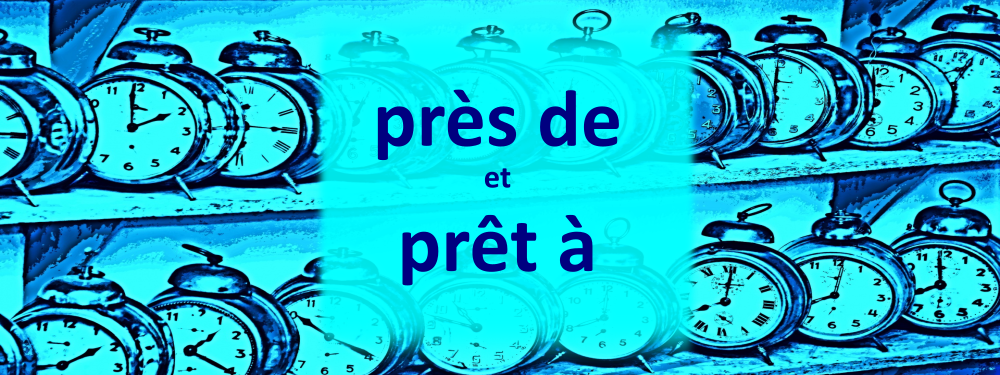« Avoir à faire » ou « avoir affaire » ? La question ne se pose pas à l’oral, car les deux expressions sont homophones, c’est-à-dire qu’il s’agit de deux éléments linguistiques qui se prononcent de la même façon. Il convient en revanche de connaître les règles pour ne pas commettre de fautes à … Lire plus